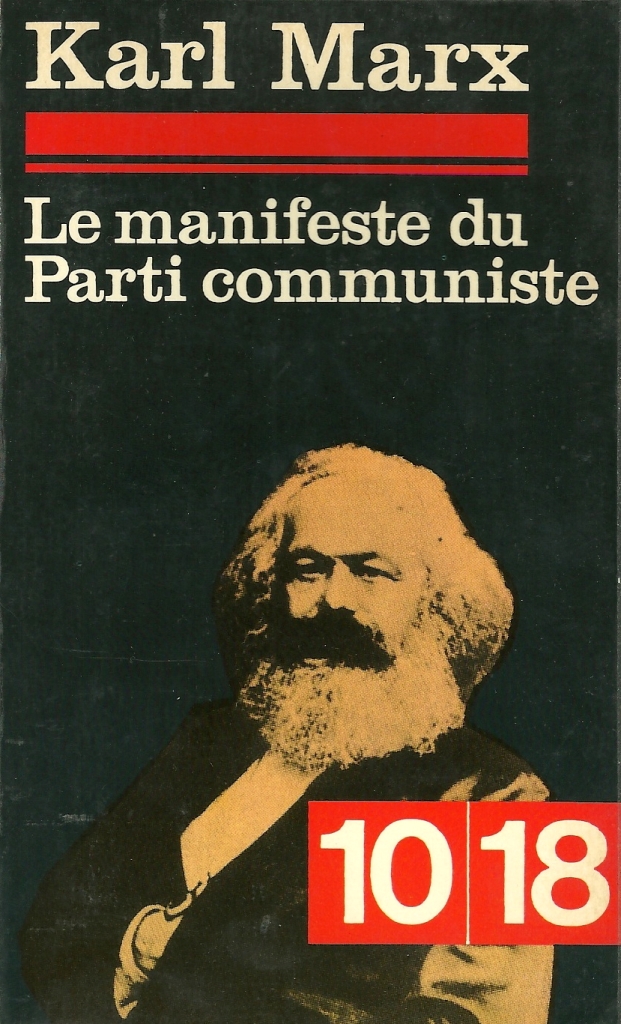Par Denis Collin pour Le Comptoir
Il y a vingt ans, Michel Houellebecq publiait « Plateforme» , un roman qui a pour terme l’organisation mondialisée du tourisme sexuel, en liaison avec un grand groupe hôtelier. Cet aspect du processus de production de la plus-value, s’il a certainement pris pas mal d’ampleur avec Internet, n’est certes pas le secteur principal de l’accumulation du capital, mais la forme de rapports sociaux qu’il implique s’est passablement généralisée. Le mode de production capitaliste aujourd’hui est largement dominé par les plateformes devenues les plus grands centres d’accumulation.
Comme les proxénètes branchés du roman de Houellebecq, les plateformes mettent en relation acheteur et vendeur encaissent la part du lion des fruits de ce commerce. On accordera que le marché de la prostitution n’a rien d’un marché libre où acheteurs et vendeurs se rencontrent et passent librement contrat. Il en va de même avec la plateforme.
La première idée qui est venue quand le réseau Internet a commencé à se déployer fut de vendre des services. La chose avait été testée en France par l’intermédiaire du Minitel, dont on rappellera qu’un des secteurs les plus lucratifs fut le « minitel rose » permettant à Xavier Niel, fondateur de Free, de faire fortune. Le Minitel offrait trois types de services, des services gratuits (services publics, essentiellement ou services de connexion au système de commandes d’un vendeur, des services bon marché, taxés à la connexion et des services payants taxés à la durée, ce qui était le cas du « 36 15 ». La première idée fut de transposer ce modèle sur Internet en généralisation de service payant. Mais l’explosion de la « bulle Internet » au début des années 2000 démontra inefficacité de ce modèle. Les sociétés opérant directement sur Internet proposent un service gratuit (par exemple un service de recherche des sites et des pages, comme Google), lequel service gratuit utilise les données de l’utilisateur pour les revendre à un marchand qui pourra s’en servir pour faire de la prospection. Les « réseaux sociaux » fonctionnent sur un principe semblable.
La phase suivante a été la transformation des marchands en ligne en plateformes commerciales. Amazon n’est pas seulement un supermarché qui offre ses rayons à l’acheteur qui vient flâner sur le Web. C’est aussi un fournisseur de musique, une plateforme vidéo, une plateforme d’abonnement à des sites de streaming (type OCS, Starz), etc., mais c’est bien plus que cela : le groupe de Jeff Bezos est à lui seul un marché (le « marketplace ») puisqu’Amazon sert d’intermédiaire à de très nombreux revendeurs qui vendent leurs produits par l’intermédiaire du réseau Amazon. Si vous voulez acheter une tondeuse à gazon, vous pouvez la commander sur Amazon mais elle sera vendue par un autre site de vente en ligne (type « espace-bricolage ») qui lui-même revend les produits d’un grossiste. Mais si les critiques visent d’abord Amazon, toutes les enseignes qui font de la vente en ligne procèdent de la même manière : la FNAC, ManoMano, But, Darty, toutes sont des plateformes de vente en ligne où viennent d’autres vendeurs qui eux-mêmes sont souvent des revendeurs.
« Amazon révèle un des secrets de l’intelligence artificielle des réseaux : il y a quelqu’un dans le ventre de la machine et ce sont les millions de petites mains qui alimentent le monstre. »
On n’allait pas s’arrêter en si bon chemin. La plateforme produit ou plus exactement supervise la production de petites mains qui viennent alimenter la plateforme : ainsi Amazon par l’intermédiaire du système KDP-Amazon (Kindle-Direct-Publishing) publie des livres en autoédition en s’assurant le plus souvent l’exclusivité sur le titre. Un livre ainsi autoédité s’est retrouvé dans la première liste du Renaudot 2018. Est-ce que cela ira plus loin ? Netflix est bien à Cannes, pourquoi pas Amazon au Goncourt, au grand dam de ces maisons d’édition qui ont monopolisé le prix depuis des décennies.
Automate 2.0
La plateforme est aussi une donneuse d’ordre. Le « Amazon Mechanical Turk » est une plateforme où des tâches sont offertes par des demandeurs (par exemple, vérifier la correction de la numérisation d’un paquet de dossiers) et où des individus viennent proposer leur service, généralement à des prix très bas. Pourquoi ce « Turc mécanique » ? En référence à la machine du baron von Kempelen, cette machine-canular censée jouer aux échecs, alors qu’un nain était caché à l’intérieur de la machine et commandait directement le déplacement des pièces par un jeu de miroir. Amazon, sachons-lui en gré, révèle ainsi un des secrets de l’intelligence artificielle des réseaux : il y a quelqu’un dans le ventre de la machine et ce sont les millions de petites mains qui alimentent le monstre.
Ces plateformes informatiques jouent d’ores et déjà un rôle économique considérable et nous n’en sommes peut-être qu’au début. Le développement du télétravail et de la société sans contact a fait naître de nouveaux besoins et ce n’est pas sans raison que l’une des têtes pensantes du Forum économique mondial de Davos voit dans la pandémie de Covid 19 une « fenêtre d’opportunité » permettant d’opérer le « great reset », la grande réinitialisation du système dont le « numérique » sera la colonne vertébrale.
Machines centralisatrices
On évoque souvent le poids des GAFA ou plus exactement des GAFAM, puisqu’il ne faut pas oublier la petite entreprise de Bill Gates. Voici les six plus grosses capitalisations boursières au monde à la fin de l’année 2020 (en milliards de dollars) : 1) Apple, 2 244 $, USA ; 2) Saudi Aramco, 1 865 $, Arabie S., pétrole ; 3) Microsoft, 1 684 $, USA, technologie ; 4) Amazon, 1 592 $, USA, technologie ; 5) Alphabet (la maison mère de Google), 1 175 $, USA, technologie ; 6) Facebook, 761 $, USA, technologie.
Une seule société n’est pas issue de l’Internet, la Saudi Aramco, la compagnie pétrolière saoudienne, figure dans ce peloton de tête. En 7e position, on trouve un géant chinois de l’Internet, Tencent et en 9e une plateforme chinoise géante, Alibaba ! À titre de comparaison, le premier constructeur automobile, Toyota, ne figure qu’à la 31e position, la multinationale du pétrole Exxonmobil à la 57e et Total est à la 100e position. La capitalisation de Total est à peu près égale au 1/20ème de celle d’Apple. Les sociétés comme Apple ou Microsoft dominent le marché du logiciel et de la marque, mais font construire ailleurs leurs machines.

Le plus étrange est que ce classement n’a aucun rapport avec celui du chiffre d’affaires. Wallmart, géant de la distribution, arrive en tête alors qu’il ne figure pas dans le « top 100 » de la capitalisation. On retrouve dans le classement du chiffre d’affaires des choses plus habituelles comme Toyota, VW, les compagnies pétrolières, etc. Pour les bénéfices, c’est Apple qui est en tête, mais c’est l’exception. Aucun des autres géants de l’Internet ne fait des bénéfices particulièrement faramineux. Et au nombre de salariés, c’est Wallmart qui est en tête avec 2300 000 salariés. Amazon est lui en 10e position avec 566 000 salariés.
Tous ces chiffres vont faire retourner à l’école les marxiste vulgaires : il n’y a pas de rapport direct entre la valeur produite et la capitalisation ! Le capital productif permet d’extraire la plus-value, mais c’est un capital « improductif » (l’intermédiaire) qui empoche le profit. En effet, l’organisation du mode de production capitaliste ne peut se comprendre que d’un point de vue global. La plus-value n’est pas produite individuellement par chaque capitaliste dans son entreprise, mais globalement, et elle est répartie, par l’intermédiaire du marché, en fonction de toutes sortes de critères que Marx avait partiellement détaillés dans le livre III du Capital et qui incluent la productivité du travail, mais aussi toutes sortes de dispositifs institutionnels et les rapports de force entre États et fractions de la classe dominante.
Ce qui a changé et qui donne une drôle de tête à ce fameux « libéralisme » ou « néolibéralisme » qui a tant obnubilé les esprits, c’est que le marché est pour une bonne part un « pseudomarché ». La plateforme est un marché à elle toute seule et c’est elle qui contrôle l’accès au « marché » d’une myriade d’entreprises de toutes tailles. Si nous étions dans un mode de production capitaliste entièrement libéral, les capitaux n’afflueraient pas vers l’entreprise de Jeff Bezos, mais plutôt vers des entreprises capables de verser des dividendes à leurs actionnaires, parce que s’y produisent des marchandises avec une bonne productivité. Amazon ne doit pas sa fortune à sa rentabilité propre, mais au fait qu’elle peut obtenir un monopole et éliminer ou asservir tous les petits acteurs des divers marchés couverts par cette firme. Mais, globalement, la production de la plus-value étant insuffisante pour l’ensemble des secteurs du mode de production capitaliste, la production de capital fictif vient y suppléer : on achète une action non parce que l’entreprise gagne de l’argent, mais parce que son action monte et promet encore de monter — c’est typiquement le cas de Tesla, modeste producteur d’automobiles qui, pour l’heure, n’a pas gagné un dollar avec ses véhicules électriques de grand luxe. Tout le monde sait que les arbres ne montent pas jusqu’au ciel, mais en attendant, chaque petit sou doit être pris. Ce système est condamné à terme. Mais à terme, nous sommes morts, comme le faisait remarquer Keynes.
Reféodalisation du monde

Il y a bien un lieu dominé par le marché, mais c’est un marché spéculatif dans une économie dominée par les plateformes qui vassalisent de nombreuses autres entreprises en leur donnant un accès à un plus large éventail de consommateurs. Cette évolution des plateformes s’inscrit clairement dans la « reféodalisation » du monde diagnostiquée par plusieurs auteurs comme Alain Supiot. Certaines des entreprises qui contrôlent le marché de l’informatique sont de véritables monopoles jouissant de rentes ahurissantes. Sur chaque PC vendu dans le monde, Microsoft empoche entre 145 € et 265 € ! Apple s’est constitué son marché avec des produits qui sont surtout des marqueurs d’appartenance sociale et qui sont sur le même créneau que la Rolex ou les Ray-Ban. Mais comme la Rolex ne donne pas une meilleure heure qu’une montre à 30 €, la quincaillerie d’Apple, fabriquée au même endroit que les autres quincailleries, ne rend pas un meilleur service. Nous sommes dans les formes les plus archaïques du fétichisme de la marchandise dont parlait Marx.
« Le capital productif permet d’extraire la plus-value, mais c’est un capital « improductif » (l’intermédiaire) qui empoche le profit. »
Cette place prédominante des plateformes contribue à la désagrégation de la classe ouvrière qui devient de moins en moins capable de résister aux assauts du capital. Uber, Deliveroo et tutti quanti sont des principales têtes de pont d’une offensive anti-sociale de grande envergure. Le prolétariat comme « sujet révolutionnaire » (du moins le croyait-on) cède la place à un « précariat » qui n’est qu’une plèbe mondialisée, où, à côté d’ouvriers salariés « à l’ancienne », figurent des travailleurs à temps partiel, des travailleurs à façon, des travailleurs « uberisés », des indépendants qui n’ont d’indépendants que le nom. En face de ce prolétariat, il n’y a plus une classe bourgeoise liée par une certaine vision du monde et des « valeurs » plus ou moins solides, mais une nouvelle classe de seigneurs, qui ont évincé ou sont en voie d’évincer la vieille bourgeoisie, se sont octroyé les services d’une classe moyenne supérieure qui vit des miettes (abondantes tout de même) de la « mondialisation capitaliste » et a pour fonction de mobiliser au service du capital un lumpenprolétariat « progressiste » qui sert de bélier pour briser tout ce qui pourrait résister au rouleau compresseur capitaliste.
Si l’on ne tient pas compté de la structure du mode de production capitaliste aujourd’hui, on ne comprend rien à ce qui se passe sur l’arène de la politique. On vit encore avec des schémas d’il y a un demi-siècle ou un siècle. Ce qui explique la décomposition accélérée ces dernières années des organisations ouvrières traditionnelles, décomposition d’autant plus rapide qu’une partie importante des sommets de ces organisations sont intégrés au fonctionnement d’ensemble de la machine à exploiter le travail.
Par Denis Collin pour Le Comptoir
- Au Comptoir, nous montrons Comment l’entreprise capitaliste façonne la société à son image
- Les cours d’Alain Supiot « Les figures de l’allégeance (la reféodalisation des institutions) » sur France Culture
- « Que reproche-t-on précisément à Amazon ? « se demande Christian Chavagneux sur Alternatives Economiques
- Se procurer l’ouvrage de Bernard Maris, Houellebecq économiste, chez votre libraire
L’ère du capitalisme absolu

Par Denis Collin pour Le Comptoir
Quelques sondages récents ont souligné une nouvelle fois le déclin irrémédiable de la gauche en France. Il semble bien, sauf retournement improbable à quelques mois de la prochaine présidentielle que l’essentiel se jouera entre le « centre droit » (Macron, LREM), la droite classique (LR) et le RN de Marine Le Pen. La gauche semble vouée à faire de la figuration au premier tour pour se partager un bon quart des électeurs. Cette situation n’est pas propre à la France. La puissante social-démocratie allemande est en voie de lente disparition. En Israël, le parti travailliste qui longtemps fut le pilier de ce pays joue maintenant les utilités. Au Royaume-Uni, les conservateurs rénovés par Boris Johnson ont fait s’écrouler le « red wall » travailliste. Nos voisins italiens, dont nous sommes souvent si proches, ne connaissent plus, en matière de gauche, que le « centrosinistra », le centre gauche qui, politiquement, n’est pas bien différent de LREM. La liste est longue ! Mais nous pouvons, sans être exhaustifs, commencer à réfléchir sur ce qui apparaît bien comme un changement d’époque historique.
Ce qui est épuisé, c’est tout un ensemble de catégories politiques ruinées par l’évolution du mode de production capitaliste au cours des dernières décennies. Pour caractériser cette évolution, il est sans doute pertinent de reprendre l’expression du philosophe italien Diego Fusaro, « Capitalisme absolu ». Ce capitalisme est absolu pour plusieurs raisons. D’une part, il a rompu tous les liens avec les formes sociales qui l’avaient précédé. Les appartenances familiales, nationales, religieuses, n’ont plus aucune place : les individus sont des individus interchangeables, mobiles, nomades, qui doivent pouvoir circuler à volonté dans le marché mondial du travail. Accumuler du capital et accumuler du patrimoine, cela n’a rien à voir. L’impératif du capital est de circuler en permanence, alors que le patrimoine, l’usine fondée par le grand-père, la maison de famille, tout cela est du capital mort, empâté dans la matière, alors que la fluidité est la vertu première du capital. On l’a trop oublié : Marx, dans Le Manifeste du parti communiste, définit la bourgeoisie comme la grande classe révolutionnaire et le mode de production capitaliste ne peut survivre qu’en révolutionnant en permanence les forces productives et les rapports de production.
Le capitalisme actuel peut être dit absolu en un deuxième sens : il règne sans partage. Le capitalisme de la période antérieure soulevait deux types d’oppositions qui pouvaient se combiner : l’opposition de la classe ouvrière — le mode de production capitaliste produit son propre fossoyeur — et celle d’une partie de classe dominante, notamment chez les intellectuels, porteurs de ce que Hegel nommait « conscience malheureuse », c’est-à-dire la prise de conscience de l’opposition entre les idéaux proclamés par les révolutions bourgeoises du XVIIIe et XIXe siècle et la réalité concrète du mode de production capitaliste. La culture bourgeoise, la « grande culture » comme dirait Adorno, est, de fait, devenue incompatible avec le mode de production capitaliste au stade actuel. La véritable opération de destruction de la culture menée par une fraction de la « classe capitaliste transnationale » prend ainsi son sens. Les prétendus « éveillés » (woke), les activistes transgenristes et autres « décoloniaux » sont l’aile marchande du capital, son extrême gauche et rien d’autre.
Pendant ce temps, la classe ouvrière a été méthodiquement pulvérisée par la mondialisation et la réorganisation du capital. Significativement, l’industrie automobile française est en voie de disparition — on annonce dans certains milieux économiques que, d’ici à la fin de la décennie, plus aucune voiture ne sera construite en France. Autour de la « numérisation » de l’économie — le « great reset » dont parle le forum de Davos — se joue une réorganisation structurelle du mode de production capitaliste avec le nouveau pilier qui n’est plus l’entreprise, mais la plateforme (Amazon et ses émules) qui joue à la fois le rôle de marché et d’organisateur de la production sans avoir à en supporter les coûts et les risques. Ce qui conduit à la transformation du prolétariat traditionnel en un « précariat », mêlant salariés aux statuts précaires et pseudo travailleurs indépendants — en réalité des travailleurs à façon comme l’étaient les Canuts lyonnais dans les années 1830.
Ces transformations n’ont pas été combattues, mais accompagnées et même précédées par les partis de la gauche. Champion des revendications « sociétales », les partis de gauche ont tourné résolument le dos non seulement aux revendications des ouvriers et employés, mais aussi à leurs préoccupations et à leur mentalité. Ils recrutent électeurs et militants dans les classes moyennes supérieures instruites, habitant les centres-villes des grandes métropoles. Ces partis sont des éléments, bientôt inutiles d’ailleurs, de la classe capitaliste transnationale.
« La classe ouvrière a été méthodiquement pulvérisée par la mondialisation et la réorganisation du capital. »
Dans ces conditions, sur le plan social, la gauche et la droite se valent, dans l’opinion de ceux que le géographe Christophe Guilluy appelle « les gens ordinaires ». C’est parce qu’ils sont rationnels et qu’ils comprennent assez bien ce qui est en question sur le théâtre politique que les membres des classes populaires préfèrent aujourd’hui voter pour Marine Le Pen plutôt que pour Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, les donneurs de leçons dénonceront l’abrutissement des masses par les médias et les réseaux sociaux, ou leur « aliénation ». On connait le mépris des gens qui se croient instruits pour « ceux d’en bas ». Mais en réalité, le « progressisme » apparaît comme la principale menace pour les classes pauvres, pour ce précariat qui subit le « progrès » dans ses pires aspects. Être conservateur, au moins, c’est se prononcer pour conserver ce que l’on a, les acquis sociaux des décennies de luttes ouvrières, mais aussi un certain genre de vie auquel les « gens ordinaires » sont attachés. Quand l’internationalisme a été liquidé au profit du mondialisme, le retour à la nation apparaît, pour certains membres des classes populaires, comme un ultime refuge.

Grève des livreurs Uber et Deliveroo à Reim
De cette situation, il ne sera pas facile de sortir. En effet, toute marche arrière est interdite : on ne peut pas revenir à la situation des « trente glorieuses » et au « partage » (produit d’un rapport de forces) entre capital et travail : la combinaison des destructions massives, de l’hégémonie des États-Unis et de la puissance soviétique ne reviendra pas. Pas plus que ne reviendra l’énergie abondante et bon marché qu’était le pétrole. On ne peut compter sur la croissance infinie pour permettre à toutes les aspirations de coexister et on sait bien qu’il n’est guère possible que les pauvres s’appauvrissent indéfiniment et que les riches continuent de s’enrichir. Tout indique qu’à moyen terme nous connaîtrons une crise économique et sociale de grande ampleur et personne ne peut exclure une catastrophe de type troisième guerre mondiale dont les conséquences seraient autrement effroyables que celles de la deuxième. Comme il n’y a pas de grand complot dont il suffirait de démasquer les comploteurs, mais ce que ce qui est en cause, c’est le grand automate qu’est le capital, c’est à une révolution radicale qu’il faut nous préparer, pas seulement une révolution sociale, mais aussi une révolution morale.
Au « toujours plus », au délire de toute-puissance de l’homme qui croit se faire tout seul, il faut substituer le sens des limites, de la juste mesure et retrouver la communauté politique comme lieu où peut se penser véritablement le bonheur. On se souvient peut-être qu’un des groupes post-soixante-huitards avait pour devise : « Nous voulons tout, tout de suite, vivre sans entraves et jouir sans temps mort. » Cette devise n’avait absolument rien de révolutionnaire, contrairement à ce que croyaient ses auteurs, elle était exactement la devise du capitalisme absolu et c’est à cela que nous devons tourner le dos, définitivement après quelques siècles de croissance de la richesse et de la puissance.
Par Denis Collin pour Le Comptoir
- Au Comptoir, nous expliquions comment le capitalisme a récupéré le concept stoïcien de « Citoyen du monde »
- Lire aussi notre analyse de l’expansion du progrès technologique : « Un robot m’a piqué mon job »
- Pour le journaliste Gérald Andrieu « Une partie du pays a choisi d’entrer en sécession civique »

Entretien avec Denis Collin: pour une défense de l’État national ! Pour la Tribuna del pais vasco, traduit par Euro-Synergies.

Pourquoi un livre pour la défense des États-nations?
Ce livre est un recueil d’articles écrits au long des années et qui ont été rassemblés et traduits par Carlos Javier Blancos que je remercie vivement. Ma démarche est d’abord celle d’un “marxiste vieille école”. Je me demande quelles sont les meilleures conditions pour lutter contre le capitalisme et oeuvrer pour une société plus juste. En travaillant sur l’oeuvre politique de Marx, deux choses finissent par me sauter aux yeux. Marx dit: la lutte de classe est internationale dans son contenu, mais nationale dans sa forme. C’est pourquoi, à la différence des anarchistes, il pense essentielles la conquête et la transformation du pouvoir d’État. Ensuite quand l’association internationale des travailleurs est fondée en 1864, les points les plus importants sont la défense des luttes nationales des Polonais et des Irlandais. Il est clairement dit par là que l’internationalisme suppose l’existence des nations et leur reconnaissance. Bref, l’internationalisme est l’opposé du cosmopolitisme et du mondialisme.
Cette démarche théorique se combine chez moi avec un évolution qui se précipite à la fin des années 1980 quand je comprends que l’Union Européenne est un carcan passé autour du cou des peuples. Je soutiens Jean-Pierre Chevènement dans le combat pour le “non” au référendum de Maastricht. Et depuis je n’ai jamais dévié de cette ligne que j’ai plutôt raffermie.
Quand le modèle de l’État-nation a-t-il commencé à être remis en question?
Si on remonte très loin, on peut dire que le modèle de l’État-nation est mis en question quand se développe l’impérialisme. L’impérialisme n’est pas le prolongement de l’État-nation, mais sa subversion par les intérêts privés. Ici, je trouve très éclairantes les analyses d’Hannah Arendt dans son livre sur l’impérialisme. C’est encore Arendt qui dit que les frontières nationales sont comme les murs qui empêchent le monde de s’effondrer. C' »est tout un pan de la pensée d’Arendt qu’on a laissé dans l’ombre.
La Première Guerre mondiale a été le premier coup porté aux États-nations. Mais c’est surtout avec la Seconde Guerre mondiale que se mettent en place les premières institutions de « gouvernance globale », sous couvert de l’ONU ou en dehors comme l’OTAN, le GATT. On est entré à ce moment dans l’ère de la souveraineté limitée.
Quelle est la signification de l’État-nation dans un monde globalisé?
Dans un monde globalisé, l’État-nation est un archaïsme ! L’échelon national ne doit plus être qu’un échelon administratif de l’ordre capitaliste mondial. Dans un texte prémonitoire daté de 1924, Trotski écrivait : « Au fur et à mesure que se développeront leurs antagonismes, les gouvernements européens iront chercher aide et protection à Washington et à Londres ; le changement des partis et des gouvernements sera déterminé en dernière analyse par la volonté du capital américain, qui indiquera à l’Europe combien elle doit boire et manger… Le rationnement, nous le savons par expérience, n’est pas toujours très agréable. Or, la ration strictement limitée qu’établiront les Américains pour les peuples d’Europe s’appliquera également aux classes dominantes non seulement d’Allemagne et de France, mais aussi, finalement, de Grande-Bretagne. » À quelques détails près, c’est le régime que nous connaissons. Les États-Unis décident en dernière analyse qui sera le « Gauleiter » de telle ou telle région d’Europe. On voit le sort de la pauvre Italie où la pusillanimité des « Cinq étoiles » et de la Lega a fini par redonner le pouvoir à l’agent de Goldman Sachs intronisé par l’UE.
ONU, OTAN, Union européenne, Organisation mondiale du commerce, Organisation mondiale de la santé … Est-il encore possible de défendre les États nationaux?
Ne cachons pas que la défense des États nationaux est devenue très difficile. L’imbrication des économies est telle que le retour à la souveraineté pourrait apparaître comme un pari risqué. Après tout, la France qui était un des grands pays producteurs d’automobiles ne produit plus sur son sol que 18% des automobiles immatriculées en France… Par exemple, Citroën est presque une marque espagnole! La pandémie a montré la faiblesse structurelle des pays d’Europe sur le plan industriel. Il n’est pas certain d’ailleurs que l’Allemagne elle-même soit aussi solide qu’elle en a l’air sur ce plan. Mais nous avons, dans l’âme de nos peuples, des forces prêtes à passer à l’action, à se retrousser les manches. Il ne faudrait pas des décennies pour reconstruire une industrie automobile ou informatique digne de ce nom.
En outre, je crois que les nations perdantes de la mondialisation pourraient aisément s’entendre. La France, l’Espagne, le Portugal et l’Italie ont tant de choses en commun et leurs peuples se sont tant mélangés qu’une alliance du Sud pourrait rapidement rebattre les cartes. Et de plus nous parlons tous un dialecte du latin !
Comment la défense de l’État-nation doit-elle être menée?
La défense de l’État-nation exige que l’on brise le carcan des accords internationaux, notamment les traités européens et les différents traités transatlantiques. On apprend, par exemple que la Bulgarie est condamnée par les instances bruxelloises parce les commerçants y ont l’obligation de mettre au premier plan des produits alimentaires les produits locaux (fruits et légumes, laitages…) ! Pourtant on nous raconte toutes sortes de fables sur la transition énergétique et la priorité à la production locale. Mais le local fausserait donc la « concurrence libre et non faussée. » On pourrait multiplier les exemples de ces absurdités nées dans le cerveau des bureaucrates européistes et de leurs maîtres.
De son point de vue, la revendication de l’État national ne peut se faire qu’auprès des classes populaires. Pourquoi?
Je crois, comme mon ami Diego Fusaro que la classe bourgeoise comme classe nationale, attachée à son patrimoine et à certaines valeurs n’existe plus à l’âge du « capitalisme absolu ». Nous avons affaire à une « classe capitaliste transnationale », très bien analysée voici une vingtaine d’années par Leslie Sklair. Par exemple, en France, nous avons un nouveau milliardaire, c’est le PDG de la société américaine « Moderna » ! Cette classe capitaliste transnationale s’appuie sur toute une classe plus ou moins intellectuelle qui se nourrit des miettes tombées de la table de la mondialisation : traders, experts, spécialistes du marketing, « auditeurs », « coaches », toute classe purement parasitaire qui a tout intérêt à ce que les choses continuent en l’état.
Donc les seules forces vraiment intéressées à la défense de l’État-nation sont celles pour qui il est la seule protection : les ouvriers, les travailleurs indépendants, les petits patrons, les précaires « uberisés » et sans doute quelques vestiges de l’ancienne classe dominante qui ne veulent pas voir disparaître ce en quoi ils croient. Tout cela peut faire un « bloc de classes », dans l’optique envisagée jadis par Gramsci. Les Gilets Jaunes avaient un temps esquissé un tel bloc.
Quelle devrait être la bonne organisation d’une Europe des États-nations?
Je suis pour une Europe confédérale, c’est-à-dire une association d’États-nations souverains qui s’engagent à ne pas se faire la guerre, à s’épauler quand l’un est menacé et à coopérer sur des projets concrets (comme on l’avait fait jadis avec Airbus). On pourrait avoir une monnaie commune, mais pas une monnaie unique, et avoir ainsi un système à deux monnaies, la monnaie nationale et la monnaie commune, qui laisserait une grande souplesse aux différents États pour gérer leur politique monétaire. Mon Europe, c’ est au fond le Projet de paix perpétuelle imaginé par Kant voilà plus de deux siècles! Une bonne partie des institutions européennes actuelles sont des bureaucraties nocives dont il faudrait se débarrasser – y compris le prétendu « parlement européen » qui n’est qu’une assemblée de bavards grassement payés. Je suis donc pour une Europe à bon marché !
Son travail chevauche la nouvelle droite et le marxisme hétérodoxe. Est-il reconnu d’une manière ou d’une autre dans les deux écoles ou est-ce que les étiquettes appartiennent au passé?
Toutes ces étiquettes appartiennent au passé. Droite et gauche sont confondues dans le culte du marché et de l’accumulation du capital. Sur les questions dites « sociétales », je crois qu’on me classera parmi les conservateurs : je suis hostile à la GPA et à la PMA, à la légalisation de l’euthanasie, comme à celle du cannabis ! Je suis également hostile à tout ce qui se trame du côté du « transgenre » qui ressemble de plus en plus à bricolage de chair humaine. Mais d’un autre côté, je pense que le seul avenir qu’aura l’humanité est un avenir communiste, c’est-à-dire un avenir où le bien commun prime sur la recherche individuelle de l’accumulation de richesse, un avenir où le travail productif est reconnu à sa juste valeur, car c’est dans le travail que l’homme exprime son essence. Mon communisme n’est pas utopique et il se confond avec la « décence commune » dont parlait Orwell. Pour donner des exemples : presque toutes les nations européennes ont un système de santé qui permet de soigner riches et pauvres indifféremment. Partout l’instruction de base est publique et à peu près gratuite. Pour moi, ce sont des embryons de communisme. Mais le plus important aujourd’hui est la revalorisation du travail, du travail manuel d’abord qui reste essentiel et le sera encore plus demain quand l’énergie bon marché sera un souvenir. Si on organise l’économie de sorte que tous les individus en état de travailler puissent vivre décemment de leur travail, alors on appliquera le principe paulinien : « qui ne travaille pas ne mange pas. »
Entretien avec Denis Collin: pour une défense de l’État national ! Pour la Tribuna del pais vasco, traduit par Euro-Synergies.